Homélies, méditations, prières, ...
Ecouter la parole de Dieu
http://dimanche.retraitedanslaville.org
Le temps du Carême
S'abreuver de l'Amour du Christ
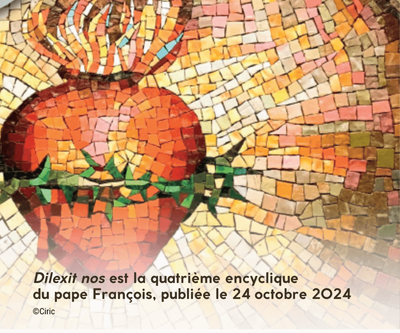
« Ce document (encyclique "Delixit nos") nous permet de découvrir que le contenu des encycliques sociales Laudato si’ et Fratelli tutti n’est pas étranger à notre rencontre avec l’amour de Jésus-Christ. En nous abreuvant de cet amour, nous devenons capables de tisser des liens fraternels, de reconnaître la dignité de tout être humain et de prendre soin ensemble de notre maison commune. » Pape François
Chercher à découvrir la réalité du « comment Dieu nous aime ».
Il est rare de parler d’un mariage dans l’Evangile. Mais c’est peut-être le mariage le plus connu au monde. A regarder attentivement, ce mariage à Cana aurait pu être oublié. Nous ne connaissons même pas le nom des mariés. Simplement son lieu de célébration. Il est dans nos mémoires à cause des invités. Il y a là Jésus et sa maman et des amis de Jésus. Jésus réalise son premier miracle. Sa maman est au départ de ce miracle. Les amis de Jésus, vont raconter ce qui s’est passé. Certains amoureux chrétiens choisissent ce récit pour leur célébration de mariage. Une célébration de mariage est une aide que les mariés se donnent à eux-mêmes pour s’aimer, l’un l’autre une vie entière. Que peut-on trouver dans ce récit qui aide à aimer ? La réponse la plus fréquente est qu’il nous fait découvrir un autre amour que celui des mariés : l’amour de Dieu pour nous et notre amour pour lui. Ste Thérèse, mais pas seulement elle, disait que cet amour de Dieu pour nous et notre amour pour lui est une sorte de mariage entre Dieu et notre âme. On a le droit d’être agacé par le mot mariage quand il on parle de cet amour qui nous est donné par Dieu. Et pourtant à la communion nous entendons ces mots : Heureux les invités aux noces de l’Agneau. Parfois une religieuse aime à se présenter comme une épouse du Christ. Peu importent ces mots : mariage, noces, épouse. Ils agacent certains d’entre nous, ils plaisent à d’autres. Cherchons plutôt à découvrir la réalité du « comment Dieu nous aime ». Sa force vient qu’il est sans condition. Il ne demande pas de retour. Malheureusement il y a des éducateurs chrétiens (parents, catéchistes et même prêtres) qui sans le faire exprès laissent croire que Dieu nous aime sous condition. La première condition serait que je l’aime à mon tour. On arrive à penser que celui qui ne donne rien à Dieu, ou même s’oppose à lui n’est pas aimé par Dieu. Quelle terrible hérésie. Dieu serait capable de ne pas aimer ? Et si Dieu est capable de ne pas aimer comment pourrais-je lui donner ma vie ? Comment serait-il ma lumière et mon salut ? Dans nos vies, la vôtre comme la mienne, particulièrement à l’adolescence arrive le moment où nous sommes tous, plus ou moins, à la recherche d’un amour sûr, partagé, sans condition. Que je sois orienté vers un amour lié à un partage de sexualité ou simplement vers une belle amitié je découvre vite qu’un jour cet amour peut devenir conditionnel. Je suis facilement dans la crainte que mes parents, mes frères, mes sœurs, mes éducateurs, le pasteur, le prêtre, le fiancé, le mari, l’épouse, le compagnon ou la compagne, pourraient cesser de m’aimer. Crainte bien compréhensible. Cependant beaucoup parmi vous, peut-être même tous, vous les adultes, vous êtes la preuve vivante qu’un amour, une amitié durent au-delà de toute condition. Vous devenez ainsi le visage humain d’un Dieu qui aime. Et vous qui êtes dans votre adolescence n’attendez pas trop de nous, vos parents, vos frères et sœurs, vos éducateurs, vos prêtres que nous soyons toujours capables de vous aimer, sans jamais vous décevoir. Mais regardez et vous voyez que nous sommes nombreux à vous aimer sans condition. Acceptez d’être aimés par nous, même si un risque de déception subsiste. Nous voulons vous aimer à la manière de Dieu. Oui, A la manière de Jésus Christ. Il n’attend rien en retour ; mais si vous lui donnez votre confiance et votre amour aucune déception venant de nous ou des autres ne vous empêchera d’être heureux. En ce jour du mariage à Cana il convient d’exprimer des vœux de bonheur. Au cours d’un mariage un prêtre, les exprimait ainsi, avec une sorte d’audace : « Ne cherchez pas à faire l’amour. Laissez-vous faire par l’amour, c’est-à-dire laissez-vous faire par Dieu ». Amen
HOMELIE POUR LE 19 JANVIER 2025 - 2e DIMANCHE DU TEMPS Ordinaire - Père Théophane, père du St Esprit (Le Bouveret, Suisse)
Prière
« J’ai besoin d’un cœur brûlant de tendresse
Restant mon appui sans aucun retour
Aimant tout en moi, même ma faiblesse…
Ne me quittant pas, la nuit et le jour. [...]
Il me faut un Dieu prenant ma nature
Devenant mon frère et pouvant souffrir ! [...]
Ah ! je le sais bien, toutes nos justices
N’ont devant tes yeux aucune valeur [...].
Et moi je choisis pour mon purgatoire
Ton Amour brûlant, ô Cœur de mon Dieu ».
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
5e dimanche de Carême
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 43, 16-21)
Psaume 125 (126)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 3, 8-14)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 8, 1-11)
Méditer
Comme il y a les devoirs de vacances, n’y aurait-il pas les « questions de carême » ? Par exemple : ai-je confiance en Dieu ? On a encore 14 jours pour répondre ! Maintenant, il est urgent d’oser des interrogations radicales. Chacun d’entre nous doit entendre cette Parole de salut. Elle vient transfigurer notre vie. Elle nous fait éprouver le Sauveur. Mais, en vérité, on est trop balourds pour le comprendre. Le Sauveur est devant moi, et je n’ose y croire… Pourtant, je le sais, il est là. Mais avec l’habitude, la monotonie, le péché, je m’encrasse…
Dieu, par sa révélation, utilise le désert comme un karcher ? Soufflant, décapant. Alors où en suis-je de l’espérance chrétienne ? Est-ce que j’y puise aussi une charité efficace qui ne passera pas ? Oui, trop souvent, le Sauveur est devant moi, et je n’ose y croire… Il me dit une parole juste ; me laisserai-je justifier ? L’histoire de la femme adultère, dans l’évangile de ce jour, nous interroge. Jésus s’adresse à celle dont la situation était sans issue : elle était vouée à la mort immédiate par lapidation ! Elle venait d’être prise en flagrant délit. La loi était claire. L’affaire était donc entendue. Pourtant, Jésus appelle la femme à la confiance.
Vous allez me dire : n’est-il pas trop tard, est-ce encore opportun ? Nous le savons : celui qui aime est patient. Le Sauveur prend le temps d’observer, d’écouter, d’ajuster sa Parole. Il pourra alors laisser jaillir la vérité comme une consolation, une espérance. Jésus est là ! Tout en lui nous parle : son silence attentif, sa Parole qui invite à regarder autour de soi, sa lucidité sur le mal, son appel à la conversion. Son amour est vrai. Dieu délivre une Parole juste, ajustée, une Parole qui délivre cette femme. Alors, répondons à la vraie question du carême : ferons-nous confiance au Seigneur ? Jusqu’à quel point ?
Source : caremedanslaville.org/meditation
4e dimanche de Carême
Lecture du livre de Josué (5, 9a.10-12)
Psaume 33 (34)
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 17-21)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-3.11-32)
Prier
Présence au cœur de nous même
« Le monde ne tient debout que par la respiration de l’amour. Tout ce qui fait du bruit autour de nous dans le vrombissement des actualités, délimite l’exact périmètre de ce qui n’est pas important. Si la terre tourne c’est grâce à des milliers d’actes d’amour que font des milliers d’hommes et de femmes qui renouvellent le matin le pacte entre la terre et le ciel - malgré tout ! Chaque matin, les hommes et les femmes qui prennent soin de la parcelle de réel qui leur est confiée - leurs enfants, leurs jardins, leurs maisons, leurs enclaves, leurs lieux de travail - sont en train de sauver le monde malgré tout.»
Christiane Singer
et :
Dans la vie, nous sommes tous des pèlerins. Chacun peut se demander : comment est-ce que je me laisse interpeller par cette condition ? Suis-je vraiment en chemin ou plutôt paralysé, statique, dans la peur et manquant d’espérance, ou bien encore installé dans ma zone de confort ?
Extrait du message de Carême du Pape François
Méditer
Le Carême est un temps de conversion et de joie. Ce dimanche célèbre la joie de la conversion – autant celle du pécheur revenant vers Dieu que notre propre conversion lorsqu’il s’agit de changer notre vision de Dieu. Jésus rencontre des pécheurs et les pharisiens en sont scandalisés. Celui qui mange avec eux ne peut être que complice du péché et partager leur impureté. Confronté à l’accusation, Jésus ne se justifie pas. Il nous montre le vrai visage du Père. Le cadet revendique sa part d’héritage. Il veut s’éloigner du père et mener une vie bien à lui. Il anticipe sa disparition et s’émancipe de son autorité. Ayant tout perdu, il décide de revenir à la maison, sans se douter que le père l’attend pour lui donner le vêtement, l’anneau de l’alliance et des sandales pour poursuivre son
chemin. Il est restauré dans sa dignité d’homme mais plus encore dans sa dignité de fils. Dieu n’est pas un juge qui sanctionne nos écarts mais un père plein d’amour qui attend patiemment notre retour. Comme les pharisiens au sujet de Jésus, le fils aîné a aussi besoin de convertir sa vision du père. Il est l’aîné obéissant et fidèle. Mais il se révèle incapable de goûter sa présence et de reconnaître son amour pour lui. Le père est encore obligé de sortir à sa rencontre. Ce ne sont pas ses œuvres qui le font vivre mais la tendresse du père. Puisse-t-il aussi entrer dans la joie du salut.
- Nous sommes sans doute les deux fils de la parabole. Quelle est notre joie en lisant cet évangile ?
- Le Seigneur est celui qui m’aime plus que je n’ai jamais été aimé, cela m’aide-t-il à vivre autrement ma foi ?
Vincent Leclercq, prêtre assomptionniste
3e dimanche de Carême
Lecture du livre de l'Exode (Ex 3, 1-8a.10.13-15)
Psaume 102 (103)
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 10, 1-6.10-12)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 13, 1-9)
Méditation
Moïse, Moïse ! L’Esprit nous appelle nous aussi par notre nom pour nous conduire sur une terre sainte, celle de notre cœur. Chaque jour, l’Esprit nous pousse à y trouver sa présence. Une condition : tout quitter, retirer nos sandales et oser pénétrer ce lieu, plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Acceptons-nous, comme Moïse, de répondre : « Me voici ! » ?
Là, l’Esprit nous fait connaître Dieu le Père et nous apprend aussi le Fils. Là, nous recueillons l’eau de la vie pour arroser la terre parfois ingrate de notre cœur. Je l’expérimente au quotidien dans le jardin du monastère. Il me faut patiemment bêcher, retourner cette terre aride pour que l’Esprit l’ensemence. Mais j’en ai l’assurance, elle portera du fruit en son temps. Et le plus beau de ces fruits est de connaître et aimer Dieu. Je vous invite à me rejoindre près de Moïse dans le désert. Fermons les yeux un instant. Du haut d’une dune, émerveillons-nous du vent qui transforme et façonne le paysage. Regardons le firmament étoilé. La création ne nous conduit-elle pas au Créateur ?
Dieu amour qui s’aime en lui-même et qui nous aime. Par l’émerveillement, entrons en relation avec lui ! Par la beauté de sa création, tenons-nous en la présence de Dieu. Laissons le souffle de l’Esprit pénétrer le souffle fragile de notre amour. Il le fortifie, l’éduque, l’élève, l’unit à l’amour même de Dieu jusqu’à n’être qu’un avec lui. Que le grand vent du désert, le vent qui guida Moïse, nous pousse sur le chemin. Allons dans le grand vent !
« Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils,
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi. » *
* Prière du Veni Creator
Source : caremedanslaville.org/meditation/1572
2e dimanche de Carême
Présence au cœur de nous même
« Le monde ne tient debout que par la respiration de l’amour. Tout ce qui fait du bruit autour de nous dans le vrombissement des actualités, délimite l’exact périmètre de ce qui n’est pas important. Si la terre tourne c’est grâce à des milliers d’actes d’amour que font des milliers d’hommes et de femmes qui renouvellent le matin le pacte entre la terre et le ciel - malgré tout ! Chaque matin, les hommes et les femmes qui prennent soin de la parcelle de réel qui leur est confiée - leurs enfants, leurs jardins, leurs maisons, leurs enclaves, leurs lieux de travail - sont en train de sauver le monde malgré tout.»
Christiane Singer
Lecture du livre de la Genèse (15, 5-12.17-18)
Psaume 26 (27)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (3, 17 – 4, 1)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 28b-36)

Méditation
Nos corps sont touchés par les éléments du Carême – prière, pénitence, partage. Il est aussi question des corps aujourd’hui : le corps glorieux du Christ, les personnes centrées sur leur nombril et les animaux comme signes de l’Alliance. L’épisode de la Transfiguration anticipe la joie pascale et témoigne d’une tension interne à la foi, entre la fulgurante rencontre du Ressuscité sur la montagne et la marche dans la plaine de nos quotidiens. Avec les disciples, nous écoutons la voix qui désigne le Christ, et nous goûtons cette Transfiguration qui nous emporte. Mais nous sommes aussi dans la plaine, prêts à témoigner comme les disciples qui, silencieux au début, ont fini par raconter ce qu’ils avaient vécu puisque saint Luc en parle. Cette même tension, entre le temps du Royaume qui vient jusqu’à nous et les conditions habituelles de la vie, explique l’exigeante affection de Paul. Il témoigne ainsi de la manière d’anticiper la vie nouvelle, à laquelle nos pauvres corps sont promis, en aimant avec passion et délicatesse. Enfin, le sommeil d’Abram est d’abord le moment de l’action de Dieu, qui consume les offrandes. En montrant que seuls les mammifères sont ouverts en deux, le récit indique l’attitude possible des humains que nous sommes, quand nous acceptons qu’un feu brûlant d’amour traverse nos vies. En ouvrant deux mains pour accueillir le corps du Christ, nous recevons des forces neuves pour la semaine qui commence, afin de vivre la Transfiguration pour le service de l’humanité.
Quels moments vais-je consacrer à la Parole ?
Vers qui puis-je tendre les mains cette semaine ?
Luc Forestier, prêtre à La Madeleine (diocèse de Lille)
1e dimanche de Carême
Lecture du livre du Deutéronome (Dt 26, 4-10)
Psaume 90 (91)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 10, 8-13)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, 1-13)

Homélie Père UWINEZA
En ce premier dimanche de Carême je voudrais vous proposer de faire notre méditation en partant du cheminement des catéchumènes pendant ce temps de Carême.
Vous le savez bien, dans notre paroisse, nous avons une vingtaine de catéchumènes : les enfants en âge scolaire, les adolescents et les adultes qui vont être baptisés à Pâques. Et nous, les baptisés, à la veillée pascale, nous renouvellerons notre baptême. Comme pour ces catéchumènes, ce temps de Carême est un temps pour nous renouveler, pour célébrer une nouvelle vie à Pâques.
Ne me posez pas la question de savoir en quoi consiste ce renouvellement, comme cet enfant qui se prépare au baptême, qui m’a demandé : « en quoi je veux changer après le baptême ? ». Une question à laquelle je n’ai pas pu répondre facilement évidemment. Mais j’ai essayé de lui dire que ce changement dépend aussi de lui.
En effet, c’est dans la discrétion avec notre Seigneur que nous pouvons définir les zones de notre vie qui ont besoin de conversion. Comme les catéchumènes qui ont vécu l’étape de l’appel décisif hier à Saint-Julien-en-Genevois, nous aussi, nous sommes appelés à améliorer notre vie spirituelle et sociale.
Les catéchumènes, par la suite, vivront les trois étapes des scrutins. Ces étapes vers le baptême consistent d’abord à les aider à rendre grâce à Dieu pour le bien qu’ils ont en eux. C’est ce que dit Moïse au peuple d’Israël dans la première lecture de ce dimanche : « lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes... , tu diras : le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à main forte et à bras étendu. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel ». Comme les catéchumènes, ce Carême peut être, pour nous, un temps pour rendre grâce pour les biens qu’il a faits pour nous.
Ensuite, l’étape des scrutins aide les catéchumènes à voir dans leur vie ce qu’il y a de faible et de malade pour le guérir. Et cela nous concerne évidemment parce que notre vie est fragile et quelque fois cède aux tentations.
Dans l’évangile, les tentations n’ont même pas épargné Jésus. Et la tentation nous promet toujours plus de bonheur que celui que Dieu nous propose par sa parole. Ces tentations peuvent se résumer à perdre confiance en Dieu. Cela se voit quand nous pensons que notre vie dépend seulement du matériel, ou que nous pouvons investir toute notre espérance ailleurs qu’en Dieu ou quand nous ne donnons pas la place à la volonté de Dieu dans notre vie.
Chers frères et sœurs, le temps de Carême est un temps particulier pour penser aux autres. Nos efforts ne devraient pas rester seulement intérieurs et individuels mais aussi extérieurs et sociaux. C’est un temps pour nous réconcilier avec Dieu mais aussi avec les autres.
Enfin, comme nous le dit notre pape dans son message pour ce Carême 2025 : « Marchons ensemble dans l’espérance ». L’espérance est “l’ancre de l’âme”, sûre et indéfectible. L’espérance ne déçoit pas.
Amen.
C'est quoi les cendres pour les chrétiens ?

Dans l'Ancien Testament, les cendres sont symboles de péché et de fragilité de l'homme. S'en recouvrir permet aux chrétiens de reconnaître leurs fautes et d'être pardonnés.
8e dimanche du Temps ordinaire
Lecture du livre de Ben Sira le Sage (27, 4-7)
Psaume 91 (92)
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 54-58)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 39-45)
Extrait de :
LETTRE ENCYCLIQUE « DILEXIT NOS »
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS
SUR L’AMOUR HUMAIN ET DIVIN DU CŒUR DE JÉSUS-CHRIST
59. Amour et cœur ne sont pas nécessairement reliés, car la haine, l’indifférence, l’égoïsme peuvent régner dans un cœur humain. Mais nous n’atteignons pas notre pleine humanité si nous ne sortons pas de nous-mêmes ; et nous ne devenons pas pleinement nous-mêmes si nous n’aimons pas. Le centre le plus intime de notre personne, créé pour l’amour, ne réalise le projet de Dieu que lorsqu’il aime. C’est pourquoi le symbole du cœur symbolise en même temps l’amour. (…)
62. Chez les Pères de l’Église, contrairement à d’autres qui niaient ou relativisaient la véritable humanité du Christ, nous trouvons une forte affirmation de la réalité concrète et tangible des affections humaines du Seigneur. Ainsi, saint Basile souligne que l’incarnation n’est pas une chose imaginaire mais que « le Seigneur a pris sur Lui les passions de la nature ». Saint Jean Chrysostome propose un exemple : « S’Il n’avait pas eu notre nature, Il n’aurait jamais été en proie à la douleur ». [38] Saint Ambroise affirme : « Puisqu’Il a pris une âme, Il a pris les passions de l’âme ». Et saint Augustin présente les affections humaines comme une réalité qui, une fois assumée par le Christ, n’est plus étrangère à la vie de la grâce : « Ce qui affecte la faiblesse humaine, comme la chair même de l’humaine faiblesse ainsi que la mort de la chair humaine, le Seigneur Jésus l’a pris non par une nécessité de sa condition, mais par sa volonté de miséricorde […] afin que, s’il arrive à quelqu’un d’être affligé et de souffrir au milieux des tentations humaines, il ne se croie pas pour autant étranger à sa grâce ». Enfin, saint Jean Damascène considère l’expérience affective réelle du Christ dans son humanité comme un signe qu’Il a assumé notre nature dans sa totalité et non partiellement, afin de la racheter et de la transformer entièrement. Le Christ a donc assumé tous les éléments qui composent la nature humaine, afin que tous soient sanctifiés.
Méditation
«On juge l’homme en le faisant parler. » « Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » À lire les textes liturgiques du jour, difficile de ne pas grimacer : les mises en garde contre les gens n’ayant pas encore pris la parole résonnent comme une sagesse dépassée à notre époque où, au contraire, les discours trompeurs surabondent. À tout prendre, on fait désormais plus confiance au silencieux qu’au beau parleur ! Ce qui révèle vraiment la valeur d’une personne, c’est la cohérence entre ses paroles et sa vie, entre ce qu’elle dit et ce qu’elle fait. Jésus a pu se distinguer par la force de son enseignement, mais en fin de compte, c’est le don de sa vie sur la Croix, puis sa résurrection, qui suscite notre foi. Cependant, les textes du jour ne sont pas moins pertinents pour autant. Ils nous invitent à écouter vraiment, à prêter attention aux mots, les nôtres comme ceux des autres. Combien de fois filtrons-nous ce qu’une personne nous dit, sans entendre son appel discret à l’aide ? Et nous-mêmes, prenons-nous le temps d’écouter ce que nous disons ? Si nous le faisions, nous prendrions conscience que nos paroles révèlent beaucoup de nos inquiétudes, de ce qui fait obstacle à la paix que Dieu souhaite nous offrir.
Ai-je déjà senti que Dieu m’interpellait à travers les paroles d’un proche ? M’arrive-t-il d’être surpris par les paroles qui sortent de ma bouche ?
Jonathan Guilbault, directeur éditorial de Prions en Église Canada
7e dimanche du Temps ordinaire
Le temps ordinaire, loin d’être « ordinaire », est une période propice pour approfondir sa foi au quotidien. Dans cette simplicité, en attendant le Carême qui commence le 5 mars 2025, nous sommes appelés à vivre notre foi avec fidélité, à cultiver la prière, et à exercer la charité.
Lecture du livre du prophète Jérémie (17, 5-8)
Psaume 1
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 12.16-20)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 17.20-26)
6e dimanche du Temps ordinaire
Lecture du livre du prophète Jérémie (17, 5-8)
Psaume 1
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 12.16-20)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 17.20-26)
5ème dimanche du Temps ordinaire
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 6, 1-2a.3-8)
Psaume 137(138)
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 1-11)
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 5, 1-11)
Présentation du Seigneur au Temple
Journée mondiale de la vie consacrée

Cette journée mondiale a été initiée par l'Eglise Catholique en 1997 par saint Jean-Paul II, qui avait souhaité que soit instituée une journée de remerciements pour la vie consacrée, c'est à dire pour toutes les personnes, prêtres, religieux, religieuses, qui ont donné toute leur vie au Seigneur. Cette journée est reconduite chaque année le 2 février car c’est le jour où les catholiques du monde entier fêtent la Présentation du Seigneur au temple, c'est à dire le jour où il est en quelque sorte consacré à l'église.
Chandeleur



Tableau du peintre flamand Pieter Aertsen - 1560
C'est le jour qui marque la fin du cycle de Noël et anticipe la lumière qui vaincra toutes les ténèbres lors de la veillée pascale. C'est en 472 que la fête de la présentation de Jésus au Temple a été associée aux « chandelles », d'où le nom de Chandeleur, par le pape Gélase 1er qui a organisé pour la première fois des processions aux flambeaux le 2 février. Il est également avancé que le pape Gélase 1er aurait offert des galettes aux pèlerins arrivant à Rome. Cette tradition en aurait été reprise par les fidèles avec les crêpes.
Lecture du livre du prophète Malachie (Ml 3, 1-4)
Psaume 23 (24)
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 2, 14-18)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 22-40)
Méditation
- Réflexion sur le ministère du prêtre ?
Prêtre de la Mission de France je suis « prêtre au travail », aujourd’hui retraité.
A l’exception de 3 années d’interruption pour des études de théologie, j’ai exercé une activité professionnelle depuis l’âge de 20 ans jusqu’à plus de 65 ans : maitre auxiliaire, informaticien, formateur en informatique, professeur assistant du chef de travaux en Lycée Professionnel. J’ai pris ma retraite professionnelle en 2014. Durant toutes ces années j’ai toujours voulu tenir ensemble compétence technique et service de la dignité humaine des personnes auxquelles j’étais envoyé. Durant 17 ans j’ai travaillé à mi-temps pour me permettre d’exercer en même temps une responsabilité pastorale (aumônerie de lycée, pastorale des migrants…). J’ai toujours cherché également à faire se parler des mondes qui souvent s’opposent : durant 18 ans j’ai été logé à Vernon par l’enseignement catholique alors que je travaillais dans l’enseignement public « laïc ».
Depuis ma retraite professionnelle je me suis engagé avec l’ADEM à Vernon, une association d’accueil de migrants en même temps que j’ai été aumônier à la préfecture de police de Paris.
Je choisis d’exprimer ce qui – pour moi aujourd’hui - « fait signe » :
La symbolique des chiffres :
J’ai été ordonné prêtre à Grenoble le 4 février 1978, voici 47 ans.
Ma formation à l’Informatique m’a rendu particulièrement sensible à la symbolique des chiffres et je trouve que cette année le nombre de 47 ans porte un message bien particulier en relation avec le ministère du prêtre !
Le prêtre est en premier lieu ministre de la Parole de Dieu (décret du Concile Vatican 2 sur la vie et le ministère des prêtres) et également ministre de l’Espérance
Le chiffre 4 : les 4 éléments : l’eau, la matière, l’air et le feu, les 4 points cardinaux et les 4 saisons sont les signes de notre commune humanité
Le chiffre 7 : Les 7 jours de la création, les 7 dons de l’Esprit Saint et les 7 sacrements sont les signes de la transcendance et du divin
Le nombre 47 tient ensemble le chiffre 4 et le chiffre 7. Il est la réunion de l’horizontale (notre humanité, notre solidarité humaine…) et de la verticale (la transcendance, l’Amour qui vient de Dieu). Il en va de même pour la Croix.
La Croix du Christ :
Le prêtre comme tout baptisé est configuré au Christ
La Croix du Christ est l’identité, la source de vie et d’amour pour tout chrétien.
La Croix du Christ est le croisement de la verticale, l’Amour transcendant, reçu « d’en haut » et de l’horizontale, l’amour partagé avec nos frères et nos sœurs.
Chaque femme, chaque homme (croyant ou non, baptisé ou non) porte sur son corps cette croix : les pieds sur terre, la tête au ciel (la verticale) et les bras tendus vers ses frères (l’horizontale)
Chacun de nous est cette croix, ce croisement entre la verticale et l’horizontale.
L’Amour qu’il reçoit d’en haut, il le transmet vers les autres par sa vie, ses actions (ses mains) et son amour (les bras tendus vers ses frères).
Nous sommes tous un lien entre la terre et le ciel, entre l’amour reçu et l’amour partagé.
Le ministère du prêtre :
Le prêtre est d’abord un homme avec ses fragilités et ses enthousiasmes, ses défauts et ses qualités.
Le prêtre a pour mission d’être signe de l’Amour de Dieu pour l’humanité.
Ministre de la Parole de Dieu : en Jésus la Parole s’est faite chair, elle s’est enracinée dans notre humanité
Se nourrir chaque jour de la Parole (la Bible, l’Évangile), en faire du pain et la semence par le partage de la vie des femmes et des hommes auxquels nous sommes envoyés – en particulier les pauvres, les migrants et les incroyants - pour témoigner d’abord par notre présence qui est signe.
Le disciple du Christ doit être pétri de la Parole et du partage de la vie de celles et ceux qu’il rejoint et dont il se fait serviteur, à la suite de Jésus.
La Parole est la semence qui fait lever l’Espérance au cœur des épreuves et des combats pour la vie, au cœur de notre quotidien.
Le prêtre est ministre des Sacrements et particulièrement de l’Eucharistie. Il est ministre de l’Espérance.
Le pain réunit les quatre éléments fondamentaux de la vie sur Terre : la matière (le blé), l’eau, l’air et le feu. Il devient – lors de l’Eucharistie – le réalité de l’union de la vie humaine et de la Vie divine.
Le célèbre motet « le pain des anges » de Saint Thomas d’Aquin (1264) – était chanté lors de « l’élévation » à la messe - nous dit clairement que le pain de l’Eucharistie nous préserve de « l’idolâtrie » c’est-à-dire des « faux dieux ». Notre élan vers Dieu doit être – en permanence – apuré du sentiment de domination et de puissance. La pauvreté et l’humilité sont au cœur du mystère de l’Eucharistie.
Le pain offert devient le pain reçu : nourriture céleste et présence divine.
Le ministre de l’Eucharistie atteste de cette présence.
Cette présence est un lien fort : Ce n’est plus l’absence ni le vide qui dominent. Nous ne sommes plus seuls, nous sommes présents les uns aux autres et Dieu est au milieu de nous
Désormais l’Espérance habite notre quotidien.
En cette année jubilaire « la Joie de l’Espérance » est notre chemin.
Denis Chautard
Prêtre de la Mission de France à Vernon (Eure, Normandie)
4 février 2025
« Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. » Parole bouleversante du vieux Syméon. Elle me rappelle celle d’un autre juste, Job, qui a traversé tous les malheurs en une poignée d’instants et se tient là, convaincu seul contre tous et contre toute logique, que seul son Dieu pouvait être son défenseur. Voici qu’il proclame : « C’est par ouï-dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t’ont vu » (Job 42, 5).
Le salut se trouve au cœur de notre lecture de la Présentation de Jésus au Temple. Ce rite juif auquel les parents de Jésus se plient pieusement, se conformant à la loi de Moïse. Selon cette Loi, Joseph pouvait y aller seul ; mais non, il prend avec lui Marie et l’enfant. Ont-ils pressenti qu’il se passerait quelque chose d’inouï et d’imprévisible ? Le texte ne dit rien à ce sujet, sinon qu’ils accomplissent ce qu’ils croient juste.
Jésus vient au cœur du Temple de Jérusalem, centre religieux d’Israël ; mais pas de prêtre qui aurait agréé leur sacrifice et ainsi restauré la pureté rituelle de Marie. Pas non plus de description du rite, comme déjà lors du baptême. Mais deux personnages insolites sont là, deux vieillards, Syméon et Anne.
Syméon n’a aucune fonction religieuse. Il attend la consolation d’Israël. Il n’a pas cherché à vainement combler cette attente, ce vide. Il a cru et cela lui a suffi pour traverser la vie en homme de bien. Il vient au Temple, poussé par l’Esprit, jusque-là, il avait entendu ; maintenant il voit. Il voit et le salut pour ce monde est révélé à tous, Israël et les nations. Tous. Pourtant, comme Job n’entendant qu’un long poème, Syméon ne voit qu’un enfant nouveau-né, né pauvre avec des parents qui le sont tout autant. Aucun signe fantastique.
Un Dieu en notre faveur
Le salut est révélé. Mais dans le creux de la lumière de cette naissance se profile déjà l’ombre de la violence, de la contradiction et du déchirement de la Passion. Les hommes (chacun de nous) n’accueilleront pas le Christ sans qu’il ne suscite une crise profonde. Le signe est déjà contesté et mènera l’enfant jusqu’à la mort, rejoignant le destin de tous les innocents, petits ou grands.
Le salut incarné dans ce modeste premier-né n’annule rien, n’épargne en rien des drames et des chagrins, pour ses parents déjà, sa mère qu’un glaive de douleur transpercera. Mais il les prend déjà avec lui ; en cet instant même de la confession de Syméon. Mystère et scandale du mal que rien ne vient justifier, expliquer. Simplement un enfant est là, promesse d’un Dieu en notre faveur, indéfectible.
Et puis il y a la vieille Anne, prophétesse, comme Myriam à la sortie d’Égypte, qui chante la délivrance d’Israël sur les chars de Pharaon. Anne qui a elle seule par ses 84 ans (multiplication du chiffre de l’accomplissement 7 par celui d’Israël et ses 12 tribus) récapitule la longue attente du peuple pour l’avènement d’un sauveur. Si Syméon peut s’endormir en paix, Anne, elle, annonce et annonce encore. Prophétesse oui, car c’est de vie qu’il est question.
Puissions-nous être de ces vieillards dont le cœur sait, se creuse pour scruter les presque riens (un enfant) qui donnent force et courage aux jours comme aux nuits ; gestes de relèvement, de consolation, d’encouragement, d’amitié, de présence qui aime et espère. Chacun annonce le salut.
Véronique Margron
Prieure provinciale des Dominicaines de la Présentation et présidente de la Conférence des religieuses et religieux de France.
3e dimanche du Temps Ordinaire année C
Dimanche de la Parole de Dieu

Le 26 janvier marque la 6e édition du Dimanche de la Parole de Dieu, une célébration qui aura lieu dans toute l'Église. Le pape François a choisi comme devise les paroles du psalmiste : « J'espère en ta parole » (Ps 119, 74) - Ce verset résonne comme un appel à l’espérance, un cri lancé vers Dieu dans les moments de doute, de souffrance ou de confusion.
Lecture du livre de Néhémie (8, 2-4a.5-6.8-10)
Psaume 18B (19)
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 12-30)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 1-4 ; 4, 14-21)
Méditation
Le début de l’évangile selon saint Luc montre les deux éléments nécessaires à tout accès à la parole de Dieu. Luc cherche à mettre un récit par écrit, et il prend soin de s’informer auprès de témoins. Il y a, à la fois, un support matériel et la rencontre avec des personnes. La parole de Dieu est en même temps un texte écrit et une proclamation publique. Après avoir proclamé un passage du prophète Isaïe, c’est un rouleau que Jésus rend au servant. Mais c’est sa parole vivante qui retentit pour en annoncer l’accomplissement. À notre tour, nous recevons un texte qui devient Parole dans l’action liturgique. Nous bénéficions de notre cher Prions en Église pour nous préparer. Mais c’est quand il est proclamé publiquement que le texte biblique se donne comme Parole vivante. Les caractères imprimés deviennent alors des sons que nous entendons grâce au ministère des lectrices et des lecteurs qui donnent leur voix et leur interprétation à ces mots qui, sans leur engagement, resteraient muets dans des livres fermés. De plus, des générations de commentateurs, femmes et hommes, se sont succédé pour chercher à comprendre ces textes comme une Parole qui vient interroger et nourrir. Il a fallu le ministère de scribes, de traducteurs, d’exégètes, bref, une foule de témoins pour que l’Évangile résonne dans le monde entier. En ce dimanche de la parole de Dieu, nous l’écoutons et nous communions à une foule immense de témoins, dont nous faisons partie.
- Comment puis-je être témoin cette semaine d’une Parole vivante ?
- Quel commentaire de la Bible vais-je lire en 2025 ?
Luc Forestier, prêtre de l’Oratoire du Louvre
- « Aujourd’hui s’accomplit cette parole que vous venez d’entendre »
Jésus, dans la synagogue de Nazareth, son village natal, entouré probablement de ses amis, de sa famille, annonce à tous que leur espérance s’accomplit aujourd’hui, que leur désir de salut est réalisé. Jésus est celui qui est venu porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés. Il doit y avoir, dans l’assistance des réactions différentes. Des réactions de foi, donc de joie profonde à cette annonce. C’est le cas pour Marie. Ça y est, le messie tant attendu est parmi nous. Il doit y avoir des réactions dubitatives. N’est-il pas le fils du charpentier ? Mais pour qui se prend-il ? Il y en a aussi qui n’écoutent que d’une oreille et qui sont là par habitude, d’autres qui ne comprennent pas l’enjeu, et d’autres qui ne se sentent pas concernés. Ce matin, je souhaite que nous entendions à nouveau cette parole comme si elle était actuelle. Parce qu’elle est actuelle ! La parole de Dieu n’est pas une parole du passé, une belle histoire qu’on se remémore. Elle est efficace et vivante. Cette parole de Dieu, elle trépigne de vivre en nous. Comme à l’époque de Jésus, aujourd’hui il y a plusieurs réactions à l’écoute de cette parole. Je souhaite vraiment du fond du cœur, que, pour moi comme pour vous, cette parole provoque une conversion, un véritable retournement, que nous puissions nous dire en vérité : « Oui nous avons besoin d’être sauvé, oui nous sommes prisonniers du péché, de notre volonté de puissance, notre orgueil, oui nous sommes aveugles devant l’amour de Dieu qui se déploie à chaque instant, mais oui aussi il est là à nos côtés, pour nous aimer, nous écouter, nous accueillir et nous sauver ! » Nous faisons évidemment partie de ces dubitatifs parce que nous n’avons pas assez à la foi. Alors demandons à Jésus de nous appauvrir, puisqu’il vient de nous dire que c’était aux pauvres que la bonne nouvelle était annoncée. De nous appauvrir, comme Marie, pour que nous ayons la simplicité de reconnaitre en Lui notre espérance. Oui Seigneur je sais que tu es là, que tu m’aimes, que tu me sauves, que ta parole est vivante en moi et efficace. Envoie-moi ton Esprit Saint, pour que je sois capable d’être porteur de ta parole, d’en vivre et de l’annoncer.
RCF, Mgr Emmanuel Gobilliard
- Ce n’est pas la première fois que Jésus, guidé par la puissance de l’Esprit nous amène dans la synagogue de son village, à Nazareth. Quand je passe devant l’église chez nous ou quand j’y vais pour présider une célébration, il y a un tas de souvenirs qui me remontent dans la tête : première communion, confirmation, servant de messe, ordination, et on pourrait continuer. Ça dû être semblable à ça pour Jésus. Saint Luc nous dit : « Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. »
« Selon son habitude »
On comprend que c’est un habitué. Il s’y est trouvé sans doute régulièrement avec Marie et Joseph. Dès l’âge de 12 ans, il pouvait faire la lecture. C’est là qu’il s’est nourri, qu’il a grandi, qu’il a mûri dans la foi et la prière de ses ancêtres. Comme tout bon croyant, il rejoint sa communauté à la synagogue, pour l’ouverture du sabbat.
« Il entra dans la synagogue le jour du sabbat ! »
Ce n’est pas un petit détail, comme pour nous dire que ce n’était pas un mardi ou un jeudi, mais un jour de sabbat. Les Juifs se rappellent que Dieu s’est reposé le septième jour après la création. Aussi, pour eux, Dieu a béni ce jour et l’a sanctifié. Le livre de l’Exode nous apprend que le sabbat est un signe de l’alliance perpétuelle entre Dieu et son peuple. Dans le même sens, le prophète Ézéchiel dira : « Sanctifiez mes sabbats ; qu’ils soient un signe entre moi et vous, pour qu’on sache que je suis le Seigneur votre Dieu. » Il y a un autre sens au sabbat qu’on oublie presque toujours. Le sabbat est associé à un moment crucial dans l’histoire des Juifs : la délivrance ou la sortie de l’Égypte.
Dans le livre du Deutéronome, on dit : « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d’Égypte, et que le Seigneur ton Dieu t’en a fait sortir à main forte et à bras étendu. C’est pourquoi le Seigneur ton Dieu t’a ordonné de célébrer le jour du sabbat. » (Dt 5,15) Le sabbat rappelle aux Juifs que Dieu l’a délivré de toute servitude.
Quand on parle du sabbat, on fait référence au passé, au repos de Dieu, au signe d’alliance, à la libération d’Égypte, c’est normal. Mais quand on célèbre le sabbat, il faut se rappeler qu’on ne célèbre pas seulement un passé, mais aussi un avenir, l’espérance d’une création renouvelée, l’espérance une délivrance attendue, l’espérance d’une alliance nouvelle. Ce que je dis pour le sabbat, ça vaut aussi pour le dimanche. Le ministère de Jésus et la lecture du livre d’Isaïe s’inscrivent dans la ligne du sabbat. Oui, Jésus vient pour une alliance, il vient nous délivrer, nous donner d’attendre avec espérance. La lecture du prophète Isaïe vient éclairer cette délivrance d’Israël par le messie.
« Il se leva pour faire la lecture. »
Il y a quelque chose de solennel dans ce que nous dit saint Luc : « Jésus se lève, on lui remet le livre, il l’ouvre » puis quand il a terminé « Il le referme, le redonne au servant et s’assoie. »
C’est une manière de donner une grande importance au livre de la Parole de Dieu, à la lecture du prophète Isaïe.
C’est une manière de nous dire que Jésus aussi est serviteur de la Parole de Dieu.
Ça nous renvoie à la première lecture où le peuple revenant de l’exil a redécouvert la Parole, au moment où il pouvait faire siens les mots du psaume que nous avons prié tantôt : « Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. »
À la fin de la lecture d’Isaïe, Jésus déclare : « AUJOURD’HUI s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. » Cet aujourd’hui nous renvoie au temps de Jésus, c’est-à-dire dans le passé. Mais, pour nous, que signifie cet AUJOURD’HUI ? On retrouve ce mot à plusieurs reprises dans l’évangile de Luc : «AUJOURD’HUI dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur » ; « Zachée, descends vite : AUJOURD’HUI il faut que j’aille demeurer dans ta maison » ; et sur la croix, au bon larron : « Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : AUJOURD’HUI, avec moi, tu seras dans le Paradis. » L’aujourd’hui pour nous, c’est l’aujourd’hui d’une rencontre, pas une rencontre passagère, mais une rencontre déterminante, durable et salvatrice. L’aujourd’hui, c’est pour tous ceux qui accueillent la Parole de salut dans la foi. «AUJOURD’HUI s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. »
Mgr Jean-Charles Dufour, Aumônier des Servantes de Jésus-Marie
2e dimanche du Temps Ordinaire année C
Lecture du livre du prophète Isaïe (62, 1-5)
Psaume 95 (96)
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 4-11)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 1-11)
Méditation
Les théophanies dans la bible
Qu'est-ce que la théophanie dans la Bible ?
Une théophanie (du grec ancien théos, θεός « dieu », et φαίνεσθαι, phaïnesthaï « se montrer ») est une manifestation de Dieu. Ce concept relève surtout de la liturgie et de la théologie chrétiennes.
Les théophanies de l'Ancien Testament sont toujours des événements au cours desquels ce qui apparaît n'est jamais Dieu comme se donnant à voir, mais comme Celui qui parle (au buisson ardent, à l'Horeb pour Élie, pour Samuel dans le Temple).
Dans le nouveau testament. Dans le Nouveau Testament cette fois, le baptême du Christ par Jean Baptiste est également considéré comme une théophanie puisque la voix de Dieu se fait entendre tandis que le Saint-Esprit apparaît sous la forme d'une colombe. Autre exemple : la « Transfiguration de Jésus » fêtée le 6 août.
Les « épiphanies » du Seigneur, véritable itinéraire spirituel
Le mystère du surgissement de Dieu au cœur de ce monde révèle (epiphania) la destinée de l’homme promis à la gloire, même et surtout si celle-ci passe par le signe contradictoire de la croix. C’est donc la création d’un véritable itinéraire spirituel qu’augurent les épiphanies du Seigneur dont le sens est l’accomplissement de Pâques et dont la vie sacramentelle est la réalisation.
Dire le mystère du Christ
A l’origine, la naissance du Christ fêtée en Orient et en Occident le 6 janvier n’est pas le jour J anniversaire d’une naissance mais la manifestation du mystère du Christ.
L’Épiphanie se décline en Épiphanies : de la naissance dans la chair (Noël) au premier signe manifestant la gloire (noces de Cana). La liturgie romaine invite dans la lex orandi à pousser plus loin la logique d’un temps de l’Épiphanie articulé au temps de Noël. Même conclu par le Baptême du Christ, tout le mystère de ce temps est appelé à un plus grand déploiement. Benoît XVI soulignait l’importance d’une telle approche :
« La célébration liturgique de Noël n’est alors pas seulement un souvenir, mais elle est surtout un mystère ; elle n’est pas seulement mémoire, mais également présence. Pour saisir le sens de ces deux aspects inséparables, il faut vivre intensément tout le Temps de Noël comme l’Eglise le présente. Si nous le considérons au sens large, celui-ci s’étend sur quarante jours, du 25 décembre au 2 février, de la célébration de la nuit de Noël, à la maternité de Marie, à l’Épiphanie, au Baptême de Jésus, aux noces de Cana, à la présentation au Temple, précisément par analogie avec le temps pascal, qui forme une unité de cinquante jours, jusqu’à la Pentecôte. La manifestation de Dieu dans la chair est l’événement qui a révélé la Vérité dans l’histoire. »
Par Bernard Maitte,Prêtre, professeur au séminaire d’Aix et responsable du département de pastorale et spiritualité de l’ISTR de Marseille. Membre du SNPLS
Aujourd’hui de l’inauguration du Salut, ces « Épiphanies » font surgir l’éternité :
La naissance dans la chair manifeste la venue dans la gloire du Fils de l’homme (Ap 1, 13)
La venue des mages préfigure le rassemblement eschatologique des hommes de toutes nations, tribus, peuples et langues (Ap 7, 9)
Le baptême du Christ dévoile ceux qui viennent de la grande épreuve ayant lavé leurs robes, blanches par le sang de l’Agneau (Ap 7, 14)
Les noces de Cana inaugurent le festin messianique, car elles sont venues les noces de l’Agneau et pour lui son épouse a revêtu sa parure (Ap 19, 7)
La Présentation du Seigneur, l’entrée dans son temple (2 février), est alors sa réponse à l’Esprit et l’Épouse qui disent : Viens !…. (Ap 22, 17).
Jésus était-il une théophanie ?
Tout au long de l’Ancien Testament, Dieu a représenté sa présence à son peuple de diverses manières (un orage, un trône, un guerrier, un homme), mais Jésus-Christ sert de théophanie culminante dans l’histoire : Dieu devenu homme.
Théophanies/Apparitions
Les lectures bibliques du temps pascal, comme celui que nous vivons maintenant, nous rapportent les apparitions du Christ ressuscité à ses disciples ; c’est-à-dire ceux qui l’ont suivi. Ce groupe de disciples est plus large que les « Onze ». Pensons aux femmes comme Marie-Madeleine, première apôtre de la Résurrection. Pensons à Cléophas et son compagnon d’Emmaüs (Lc 24, 18) qui ne faisaient pas partie du groupe « officiel » des Douze. Le Ressuscité s’est manifesté en apparitions à ces disciples et à bien d’autres. Dans la Bible, les apparitions constituent un des modes de la révélation de Dieu. Par elles, se rendent présents de façon visible les êtres qui, de nature, sont invisibles aux hommes. Dans l’Ancien Testament par exemple, Dieu apparaît en personne ; c’est ce qu’on appelle « théophanie ». Il manifeste aussi sa gloire ou se rend présent par son Ange. Dans le Nouveau Testament, l’Ange ou les anges du Seigneur apparaissent lors de la naissance de Jésus (Mt 1-2, Lc 1, 11.26 ; 2, 9) ou de sa résurrection (Mt 28, 2sv ; Mc 16, 5 ; Lc 24, 4 ; Jn 20, 12), pour manifester que, en ces moments majeurs, le ciel est présent sur la terre. Bien d’autres apparitions prolongent l’Ancien et le Nouveau Testament. C’est le cas, à titre d’exemple, des apparitions authentifiées par l’Eglise comme celles de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous à Lourdes, celles aux 3 enfants de Fatima, Lucie, Jacinthe et Francesco ; celles aux trois voyantes de Kibeho au Rwanda, Nathalie, Alphonsine et Marie-Claire, et bien d’autres. Par l’intermédiaire de la sa Mère, Jésus redit régulièrement son amour à ses frères et sœurs de la Terre, les visite et les invite à la prière et à la conversion. Par elles – je le répète – le ciel se rend présent sur terre. Par elles, Dieu nous visite et ouvre nos yeux à sa présence au monde. Par ailleurs, trois aspects marquent les apparitions. Premièrement, elles relèvent de l’initiative de Dieu luimême. Il ne s’agit donc pas d’une invention subjective des intéressés, provenant d’une foi exacerbée ou d’une imagination débridée. C’est Dieu qui « se donne » à voir, et non l’homme qui entreprend de voir Dieu. La foi est d’abord une initiative de Dieu, et ensuite seulement une réponse de l’homme. La foi est un don proposé à tous, qui ne demande qu’à être accueilli. Ensuite, les apparitions demandent reconnaissance de la part de l’intéressé et de l’Eglise. Car Dieu s’adresse à quelques-uns particulièrement mais pour parler à tous. Un message qui serait en contradiction avec celui de l’Evangile ne saurait être reçu. Car l’Evangile est la plus haute apparition, la plus haute parole de Dieu adressée à l’homme. Enfin, toute apparition ouvre à une mission. Le message adressé aux élus concerne tout le peuple de Dieu. Si quelques-uns sont visités par le Seigneur, c’est pour que tous bénéficient de cette visite. Et la parole de Dieu met en route. La présence de Jésus n’est pas statique ; elle est missionnaire. Cependant, remarquons que tous ceux à qui Jésus ressuscité s’est manifesté ont un point commun : en toute simplicité, dans l’ordinaire de leur vie, ils étaient tous animés d’une vraie recherche de Dieu, d’une vraie soif de Jésus-Christ. Et quand cela n’était pas le cas avant, il l’a été après cette expérience bouleversante. Partant, nous comprenons que Dieu se manifeste à ceux qui le cherchent. Heureux donc ceux qui désirent Dieu de tout leur cœur ; heureux ceux qui cherchent le Seigneur, ils seront comblés. Heureux aussi ceux qui se laissent rencontrer par le Seigneur, leur vie sera transformée par la grâce du Ciel. Et nous, où en sommes-nous ? Sommes-nous des chrétiens qui ont trouvé le Seigneur mais pour le chercher encore et encore, jusqu’à la vraie vision dans le ciel ? Quelle est notre soif de Dieu ? Bien des signes nous sont donnés. Nous n’avons pas forcément besoin d’apparitions spéciales. Sinon, le Seigneur nous les donnerait. Par contre, des événements, des signes de la présence et de l’action de Dieu dans notre histoire nous sont donnés. « Ouvre mes yeux, Seigneur, je suis l’aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir ! » Bon temps pascal, belles rencontres avec le Ressuscité !
P. Jean-Claude MUTABAZI Curé de la paroisse St François en Chablais (Thonon)
10 choses à savoir sur les théophanies
Le mot théophanie est une combinaison de deux mots grecs: Dieu et apparition. Une théophanie est une apparition de Dieu. Plus précisément, c’est une démonstration de la présence et du caractère de Dieu, que les êtres humains peuvent observer. En voici quelques exemples: la spectaculaire manifestation sur le Mont Sinaï (Ex 19), le buisson ardent (Ex 3), les apparitions à Abraham (Gn 15.1, 17.1, 18.1), à Isaac (Gn 26.2), à Jacob (Gn 28.13), le nuage de feu dans le désert (Ex 14.19, 40.34, Nb 9.15-23), la vision accordée à Michée (1 R 22.19-22), à Ésaïe (És 6), à Ézéchiel (Éz 1), Jean qui voit Dieu sur son trône (Ap 4–5).
Les théophanies révèlent Dieu à partir d’intermédiaires terrestres. Dieu se montre en utilisant des manifestations visuelles comme le feu, la nuée, ou parfois une forme humaine (Éz 1.26-27). Cela s’accompagne parfois d’éléments auditifs (tonnerre, voix, etc.) ou d’autres effets (Ex 19.18).
Dieu le Créateur ne se confond pas avec les intermédiaires terrestres qu’il utilise dans les théophanies.
En même temps, il se montre dans ces éléments et il est présent dans et à travers eux. Puisque Dieu est distinct du monde, il n’est jamais capturé par le monde; on ne peut donc pas le voir sans intermédiaire. Mais en même temps, Dieu se fait réellement connaitre quand il apparait. Son apparence reflète qui il est.
4. Les théophanies dans l’Ancien Testament anticipent et annoncent la présence permanente de Dieu dans sa création, réalisée par l’incarnation du Fils. En s’incarnant, le Fils de Dieu adopte une nature humaine, tout en restant Dieu. Le Fils est l’apparition éternelle de Dieu parmi nous. Comme Jésus a dit à Philippe: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe! Celui qui m’a vu a vu le Père; comment dis-tu: « Montre-nous le Père »? – Jean 14.9 L’incarnation est un événement unique dans toute l’histoire de l’humanité. Mais elle était déjà annoncée par les apparitions éphémères de Dieu. Toutes ces théophanies avant Jésus-Christ montraient, avant l’heure, quelque chose de ce que Dieu accomplirait plus tard, quand Christ viendrait en chair.
5. Il y a plusieurs sortes de théophanies. Par exemple: un orage, un feu, un nuage, la gloire, une salle d’audience, un visage humain, un guerrier, un chariot. Chacune de ces choses souligne un aspect du caractère de Dieu et de son interaction avec nous. Chacune préfigure la venue du Christ. Chacune est reliée mystérieusement aux autres.
6. Dieu accomplit quelque chose au travers des théophanies. En règle général, les théophanies sont des événements qui servent à établir et entretenir la relation entre Dieu et le peuple
7. Au-delà des cas évidents de théophanies, on peut parler de théophanies plus discrètes. Au sens large, chaque rencontre entre Dieu et une personne a quelque chose à voir avec la théophanie. La présence de Dieu parmi nous est semblable à une théophanie. La révélation générale de Dieu à travers la création et la providence montre le caractère de Dieu (Rm 1.18-23); dans ce sens, elle ressemble à une théophanie (Ps 104.1-3).
8. Le principe d’une théophanie reflète la nature trinitaire de Dieu. Dieu le Père se révèle au travers de la Parole dans la puissance et la gloire du Saint-Esprit.
9. La description la plus aboutie de la théophanie se trouve dans le livre de l’Apocalypse.
L’apogée de la théophanie, c’est Dieu qui habite avec nous dans la nouvelle Jérusalem:
Et j’entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux (…) Ils verront sa face, et son nom sera sur leurs fronts. – Apocalypse 21.3; 22.4
10. La théophanie, tout comme le sens plus général de la présence de Dieu, se trouvent dans toute la Bible.
Ces thèmes trouvent leur plein accomplissement en Christ:
« Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. » – 2 Corinthiens 3.18
Par : Vern S. Poythress (PhD, Harvard University; ThD, University of Stellenbosch), est professeur d'interprétation du Nouveau Testament au Westminster Theological Seminary à Philadelphia, Pennsylvania aux USA. Il y enseigne depuis presque ans. En plus d'avoir obtenu six diplômes universitaires, il est l'auteur de nombreux livres et articles sur l'interprétation biblique, le language et la science.
Fête du Baptême du Seigneur
Le baptême du Christ est un des épisodes de la vie de Jésus-Christ : son baptême dans le Jourdain par Jean le Baptiste. Il est relaté dans les trois Évangiles synoptiques. Il s'inscrit dans les trois épiphanies du Messie de Dieu avec l'Adoration des mages et les Noces de Cana. Il marque la fin du temps de Noël.Solennité de l'Epiphanie du Seigneur
Lecture du livre du prophète Isaïe (40, 1-5.9-11)
Psaume 103 (104)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14 ; 3, 4-7)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 15-16.21-22)
-
Une théophanie trinitaire
La connaissance que nous avons du Christ ne s’achève pas dans le seul face-à-face du Père et du Fils. L’Esprit est le troisième qui témoigne de la vie divine de Jésus. Celui-ci le rappelle à Nicodème et c’est l’Esprit qu’il enverra à ceux qui croient en lui. Le Père et le Fils enverront l’Esprit au long des âges. (Jean 14. 16 à 20 – 15. 26 à 16.15)
L’Esprit peut nous être donné à partir du Fils parce qu’il habite souverainement en lui. Il n’est donc pas étonnant que la mission de Jésus débute, temporellement, par une manifestation de l’Esprit liée à son Baptême et qu’elle se termine, visiblement, par le commandement donné aux Apôtres d’aller baptiser au nom du Père et du Fils et de l’Esprit. (Matthieu 28. 19) Par le baptême, l’Esprit est communiqué à ceux qui s’ouvrent à la foi.
Le Père, le Fils et l’Esprit, révélés au monde lors du baptême de Jésus, sont inséparables parce qu’ils sont relation d’amour. Nous touchons là à ce qu’il y a de plus profond et de plus intime dans le mystère de Jésus. Le ministère rédempteur du Christ en faveur des hommes rejoint la vie d’intimité du Fils avec le Père et l’Esprit.
C’est ainsi qu’il sera désormais avec nous. C’est cela qu’il exprime dans sa prière au soir du Jeudi-Saint, alors qu’il vient de partager son Corps et son Sang durant le repas qu’il prit avec ses apôtres. A nous de le réaliser en chaque Eucharistie où, nous aussi, nous partageons son Corps et son Sang « pour la Gloire de Dieu et le salut du monde. »
« Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à Lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d’auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l’Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit-Saint, nous t’en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes. » (Prière eucharistique 4)
« Dieu éternel et tout-puissant accorde à tes fils adoptifs, nés de l’eau et de l’Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. » (Prière d’ouverture de la messe)
Source : Eglise catholique de France
-
Comment ne pas profiter de la fête du baptême de Jésus pour nous laisser interpeller au sujet de notre propre baptême ?
Par le baptême, nous avons été plongés dans la mort avec le Christ pour naître à une vie nouvelle ! Quelque chose de nouveau a commencé en notre vie le jour où nous avons été baptisés. Sur les rives du Jourdain, Jean Baptiste annonçait un baptême de conversion pour que le peuple soit prêt à accueillir le Messie, celui qui baptiserait dans l’Esprit Saint et le feu. Un temps nouveau commence. Pour Jésus, la vie paisible à Nazareth se termine pour laisser place à celle de la mission. Jésus est baptisé par Jean de la même manière que le peuple dont il fait partie. Il se vit une sorte de passage de relais. Jean et Jésus accomplissent ce qui leur a été demandé. Jésus est baptisé, et commence pour lui un temps nouveau qui plonge ses racines dans la prière. L’évangile d’aujourd’hui prend soin de nous rappeler cet enracinement dans la prière, dans ce dialogue avec son Père, que Jésus ne cessera d’entretenir tout au long de sa vie, jusqu’au sommet de la Croix. C’est dans la prière que Jésus accueille l’Esprit Saint. C’est dans la prière que Jésus accueille sa mission. C’est dans la prière qu’il comprend la voix du Père : « Tu es mon Fils bien-aimé ! » C’est dans la prière, que nous aussi, nous sommes invités à discerner, à écouter la voix du Père, à répondre aux appels de notre baptême et à prendre le chemin des disciples missionnaires.
- Qu’est-ce que cela change dans ma vie d’être baptisé ? D’ailleurs, est-ce que je me souviens de la date de mon baptême ?
- La prière m’aide-t-elle à vivre en baptisé et à grandir dans l’amour de Dieu ?
Suis-je prêt à être disciple missionnaire, à être témoin de l’amour de Dieu autour de moi ?
Benoît Gschwind, évêque de Pamiers
Lecture du livre du prophète Isaïe (60, 1-6)
Psaume 71 (72)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (3, 2-3a.5-6)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 1-12)
Méditations
-
L’Epiphanie
Quelle est la signification spirituelle de l’épiphanie ?
Le nom Épiphanie vient du grec epiphaneia, qui signifie « apparition » ou « manifestation », et fait référence à la manifestation de Jésus-Christ au monde. Cette fête est également appelée fête de l'Épiphanie, de la Théophanie ou des Rois Mages.
Est-ce que tous les chrétiens célèbrent l’Épiphanie ?
Tous les chrétiens célèbrent-ils l'Épiphanie/le jour des Rois Mages ? Tous les chrétiens ne célèbrent pas le jour des Rois Mages, mais beaucoup le font . Les catholiques romains, les luthériens, les anglicans et les chrétiens orthodoxes orientaux célèbrent le jour des Rois Mages.
Qui a inventé l'épiphanie ?
L'Epiphanie est un mot grec à l'origine, epiphaneia, qui veut dire "manifestation" ou "apparition". La fête chrétienne de l''Epiphanie prolonge effectivement la fête de Noël. Elle est apparue vers le IIIe siècle, soit avant même la fête de Noël, qu'on a commencé à célébrer vers 325, à Rome.L'Épiphanie, identifiée comme le jour d'adoration des mages, a été fixée au 6 janvier en Occident pendant la deuxième moitié du IVe siècle (350), soit douze jours après Noël. On la célèbre généralement le dimanche qui suit le 1er janvier. Dans les Églises d'Orient, on célèbre plutôt le baptême de Jésus et son premier miracle aux noces de Cana
-
Hérode, c’est nous


